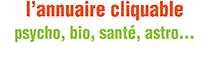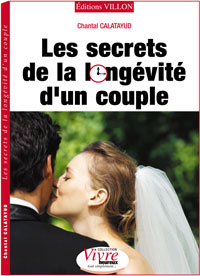« C’était dans les années 60, une vieille dame nous recevait pour notre instruction religieuse, je ne me souviens plus de son visage mais je n’oublierai jamais sa gentillesse »… Ainsi s’exprime Gilles, 54 ans, journaliste...
Il est des enseignements spécifiques qui requièrent des connaissances. L’enseignement religieux authentique nécessite une pédagogie en prise directe avec le quotidien. Il y est plus question de transmettre une énergie que d’y remplir des cahiers.
Revenir à l’essentiel
Sera-t-il religieux ou ne sera-t-il pas ? Spirituel ou pas ? André Malraux, alors ministre de la culture, parlait du XXIème siècle. Ses propos ont été interprétés tant de fois que certains en viennent à douter de l’authenticité de ses paroles. On a parlé en mal ou en bien du retour du religieux. Quoi qu’il en soit, nous y sommes, dans ce fameux siècle et la quête existentielle, elle, est toujours d’actualité… Les comités d’éthique font appel à des religieux. Le Pape, bien que controversé, alimente les conversations. Certes les églises se vident mais la question religieuse n’a jamais autant préoccupé le public, témoin la multiplicité des ouvrages traitant de spiritualité. Le « Catéchisme de l’Église Catholique », s’il explique ce que le fidèle doit croire, n’est plus le seul référent en matière de pédagogie religieuse. Le dialogue inter-religieux s’enrichit des différences. La pensée unique en la matière n’a heureusement plus cours. Jean-Paul Guetny, journaliste d’un mensuel d’actualités religieuses, écrivait déjà en 2001 : Il faut nous remettre à l’esprit que l’essence de nos religions est paix, amour, fraternité, hospitalité, et n’a rien à voir avec la destruction et la haine. Ainsi, la première qualité du pédagogue religieux est sa capacité à revenir à l’essentiel.
On reconnaît l’arbre à ses fruits
La question du prosélytisme est toujours la pierre d’achoppement lorsqu’il est question de croyances. L’Histoire enseigne qu’asséner des certitudes dans un domaine aussi abstrait que la relation au divin comporte des dérives idéologiques où la confusion des genres peut générer l’inverse de l’effet souhaité. Tout simplement parce que l’être est unique et que ce qui est bon pour l’un peut se révéler néfaste pour un autre. Tout au plus le pédagogue religieux peut-il témoigner de ce qui le fait vibrer, en laissant son interlocuteur totalement libre d’adhérer à sa croyance ou non. Il s’agit d’une relation intime que l’on peut partager mais surtout pas imposer. Quoi qu’il en soit, ce sont les actes et le comportement qui transmettent l’authenticité d’un engagement religieux. On reconnaît l’arbre à ses fruits est une parole du Christ qui interroge l’Histoire de l’Église et la remet sans cesse en question. S’il y a eu des dérives, il y a eu aussi de magnifiques personnalités qui, en son sein, ont fait avancer l’Humanité. « La vie de Thérèse d’Avila, écrite par elle-même », par exemple, est un trésor de pédagogie religieuse intemporelle, si on sait y lire entre les lignes.
Pierre Rolland
Les religions à l’école
Depuis la loi de séparation de l’Église et de l’État (1905), l’école publique considère que l’éducation religieuse ne la concerne pas, qu’elle incombe aux familles et aux institutions religieuses ; un jour de congé scolaire fut même prévu à cet effet. Pourtant, presque cent ans après (rapport Debray de 2002), on retrouve une volonté de développer un enseignement du fait religieux dans l’école laïque afin de contribuer à l’intelligence des civilisations et des évolutions passées et présentes. Ce qui n’est pas si dénué de sens que cela. En effet, notre civilisation est bâtie sur des siècles de Christianisme. Des conflits actuels ont pour toile de fond des idéologies religieuses. On mélange Islam et islamisme. On ne sait pas vraiment que le bouddhisme n’est pas à proprement parler une religion. Bref, l’Humanisme a tout à gagner en ouvrant les esprits et en ne faisant pas du laïcisme une religion de plus. Pour mieux comprendre le conflit Irak-Iran, encore faut-il acquérir une culture qui prenne en compte les différences entre chiite et sunnites. La pédagogie de la dimension religieuse de l’Humanité devrait ainsi aider en profondeur à la maturation et à la maturité des futurs citoyens. L’expérience bien comprise du passé peut en effet protéger l’avenir. À partir de là, comme le disait le psychanalyste Jacques Lacan dans un de ses séminaires : Espérez ce qu’il vous plaira !