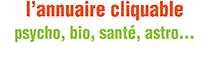Joan Miró, un geste significatif
|
Ce « Catalan international », comme il se définit lui-même, a marqué son siècle. Impossible de faire l’impasse sur cet artiste majeur du surréalisme et de l’art moderne, au style unique.
Joan Miró Ferrà naît à Barcelone le 20 avril 1893. Le futur peintre, sculpteur et céramiste, a pour mère Dolorès Ferrà i Oromi, fille d’ébéniste, et pour père Miquel Miró i Adzeries, bijoutier. Très tôt, le petit Joan est attiré par le dessin mais son père tient à ce qu’il ait une formation commerciale. Il a 17 ans lorsqu’il travaille dans une droguerie, puis dans une industrie de produits chimiques. Visiblement, cette voie n’est pas la sienne. Le jeune Miró se montre dépressif et contracte le typhus. Son père accepte enfin l’orientation artistique de son fils.
L’initiation
En 1911, Joan Miró intègre l’École d’Art de Barcelone dirigée par Francisco Galli, un architecte baroque. Il y suit son enseignement jusqu’en 1915, s’initiant aux différentes tendances de l’art européen de l’époque. Parallèlement, il fréquente l’Académie libre du Cercle Saint-Luc et perfectionne sa technique du dessin. Il se lie d’amitié avec le peintre Ricart et loue avec lui un atelier. Du 16 février au 3 mars 1918, il expose ses premières œuvres à la galerie Dalmau de Barcelone, puis entre dans le « groupe Courbet » composé d’artistes se réclamant de la peinture révolutionnaire du maître. Pendant cette période d’apprentissage tous azimuts, les toiles de Miró s’imprègnent à la fois de l’influence de Van Gogh, de Matisse et du fauvisme, de Gauguin et de l’expressionnisme, du cubisme. Miró expérimente et cherche son style propre.
Un artiste libre
Âgé de 27 ans, le jeune peintre décide de monter à Paris. Il y rencontre André Breton et le mouvement surréaliste. Si Miró se révèle un artiste ouvert et à l’affût de la modernité, il n’en reste pas moins un artiste libre. Il ne se veut inféodé à aucun groupe de pensée et si Breton dit de lui qu’il est le plus surréaliste d’entre nous, c’est avec une pointe d’humour acide. Joan Miró est un solitaire. Il ne parle pas beaucoup, se méfiant de toute conceptualisation érigée en système, aussi révolutionnaire soit-elle. Ce que je cherche, c’est un mouvement sans mouvement, quelque chose d’équivalent à ce qu’on appelle l’éloquence du silence… Je me dégage de toute convention picturale (ce poison), écrit-il. S’il aborde l’abstraction, il ne se définit pas comme un peintre abstrait. Miró possède la faculté étonnante de s’approprier un style pour mieux s’en libérer. Aucun déni ici mais plutôt un tremplin pour aller vers plus de créativité.
L’engagement républicain
Le 12 octobre 1929, Joan Miró épouse Pilar Juncosa à Palma de Majorque. Deux ans plus tard naît leur fille, Maria Dolores. En 1932, la famille s’installe en Espagne. Le maître poursuit sa recherche et aborde le collage. « Dix-huit peintures selon un collage » sont réalisées à partir d’images extraites de publicités et de revues. Les collages me servent comme point de départ pour des peintures… Je ne copie pas les collages. Simplement je les laisse me suggérer des formes, aime rappeler le peintre. Le monde ne va pas bien et les peintures reflètent l’inquiétude des temps qui viennent comme en attestent deux de ses œuvres célèbres : « Homme et femme face à une montagne d’excréments » (1935), « Femme et chien face à la lune » (1936). Au moment où éclate la guerre civile, il est à Paris pour une exposition. Il décide de ne pas rentrer en Espagne et de mettre sa notoriété et son talent au service de la cause Républicaine. Pilar et Maria Dolores le rejoignent. Il réalise l’affiche « Aidez l’Espagne » qui fait l’objet de l’édition d’un timbre destiné à soutenir les antifranquistes. Afin de sensibiliser un large public, il entreprend de peindre des toiles de grandes dimensions.
La maturité
En 1942, la France étant occupée par l’armée allemande, l’artiste fait le choix de reprendre contact avec son pays. En 1943, il s’installe dans la maison familiale à Barcelone, transformée en véritable laboratoire. Pour le galeriste John Prats, Miró réalise la série « Barcelona », comportant cinquante lithographies en noir et blanc sur lesquelles il laisse libre cours à son refus de l’oppression. Ce travail agit sur lui comme une véritable catharsis puisqu’il lui permet ensuite de se remettre à la peinture sur toile. C’est à cette époque qu’il peint des œuvres qui témoignent d’une maturité indiscutable : « Femme dans la nuit » (1944), « Au lever du soleil », « Danseuse écoutant de l’orgue dans une cathédrale gothique » (1945). Il développe en même temps la gravure, la céramique et le modelage. Sa créativité s’intensifie avec des sculptures peintes de couleurs vives et utilisant des objets du quotidien. En 1947, il illustre « L’antitête », un ouvrage de Tristan Tzara. Il récidive avec « Anthologie de l’humour noir », d’André Breton et « La clé des champs » de René Char. L’artiste est reconnu et consacré en recevant le Prix de la Gravure à la Biennale de Venise.
Aller à l’essentiel
Il est important pour moi d’arriver à un maximum d’intensité avec un minimum de moyens. D’où l’importance grandissante du vide dans mes tableaux… À partir de 1960, le peintre expérimente le monochrome s’inspirant des techniques chinoises et japonaises. Il accorde une importance extrême au mouvement du pinceau lorsqu’il dépose sur sa toile les lignes et les points. Il s’agit pour lui de reproduire le geste de l’archer japonais. Ses toiles s’épurent comme en témoigne « Le triptyque bleu ». Après avoir réalisé tout au long de son existence plus de 2 000 peintures, 5 000 dessins, 500 sculptures, 400 céramiques, 3 500 pièces en lithographie, eau forte, l’artiste exécute une ultime œuvre, « Femme et oiseau », en 1983. Dédiée à sa ville natale, la sculpture, en partie recouverte de céramique et peinte de tons rouge, jaune, vert et bleu, s’offre au public comme un clin d’œil à la vie. Joan Mirò quitte le monde à l’âge de 90 ans, le jour de Noël de la même année. Il laisse à la postérité, à Barcelone, une fondation qui porte son nom et à laquelle il a légué lui-même une grande partie de son œuvre. Une visite essentielle à faire dont on ne revient jamais indifférent !
Miguel Santos